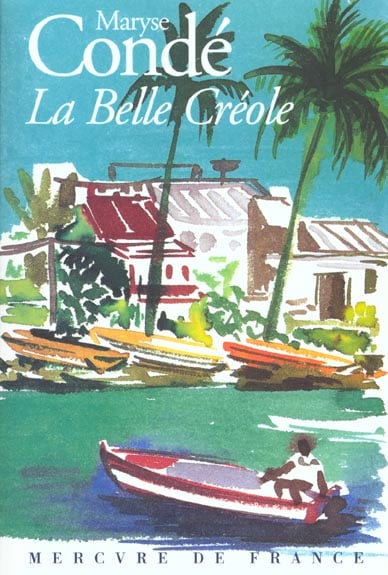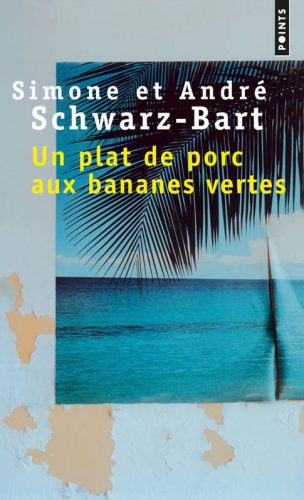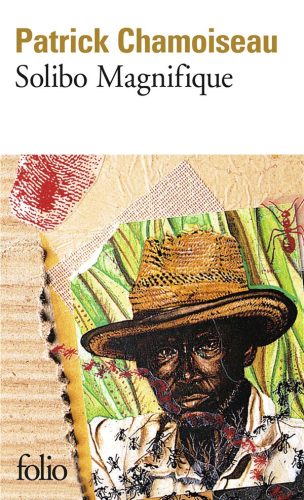C’est la suite de Le Cœur à rire et à pleurer qui racontait l’enfance de Maryse  Condé, son arrivée à Paris pour y faire de brillantes études, sa découverte d’Aimé Césaire et Frantz Fanon et son engagement politique. Elle délaisse ses études pour fréquenter les cercles antillais et africains.
Condé, son arrivée à Paris pour y faire de brillantes études, sa découverte d’Aimé Césaire et Frantz Fanon et son engagement politique. Elle délaisse ses études pour fréquenter les cercles antillais et africains.
Le journaliste haïtien, Jean Dominique l’a abandonnée enceinte pour faire la Révolution à Haïti à la veille de l’élection de Duvalier. Maryse Boucolon, en 1956 accouche d’un petit garçon et part au sanatorium de Vence guérir un début de tuberculose. après avoir mis le bébé en nourrice.
Chargée de famille, elle doit subir l’opprobre réservée aux filles-mères
« Mieux vaut mal mariée que fille «
Elle se trouve un mari africain, Condé, comédien guinéen qui l’épouse en 1958. Au bout de 3 mois, ils se séparent mais Maryse est à nouveau enceinte.
« Ce mariage avait relevé ma honte »
En 1959 elle est affectée au collège de Bingerville en Côte d’Ivoire. Elle part seule avec son fils, et enceinte. Escale à Dakar, puis Abidjan. En fait de Négritude elle découvre que les Antillais sont mal vus par les Africains, ayant servi de fonctionnaires coloniaux
« ils nous traitent de valets tout juste bons à exécuter la sale besogne de leurs maîtres »
Maryse Condé, « sans fards » ne se donne pas le beau rôle. Elle n’éprouve aucune vocation à enseigner. Elle ne cherche pas de prétexte politique à son expatriation. Malgré ses lectures enthousiastes de Senghor, elle ne tombe pas sous le charme de l’Afrique. Elle arrive pourtant dans un moment passionnant, juste avant les Indépendances, fréquente des meetings mais ne comprend pas la langue.
« En Côte d’Ivoire , j’éprouvais le sentiment qu’une nouvelle Afrique s’efforçait de naître. une Afrique qui ne se fierait qu’à ses seules forces. Qui se débarrasserait de l’arrogance ou du paternalisme des colonisateurs. J’éprouvais le douloureux sentiment d’être tenue à l’écart. «
Même la fête de l’Indépendance le 7 Aout 1960, elle est exclue.
Elle rejoint Condé, son mari, à Conakry avec ses deux enfants
De toutes les villes où j’ai vécu, Conakry demeure la plus chère à mon cœur. J’y ai compris le sens du mot « sous-développement ». j’ai été témoin de l’arrogance des nantis et du dénuement des faibles »
Elle assiste au « socialisme africain » de Sékou Touré.
Guinée était le seul pays d’Afrique francophone à se vanter de sa révolution socialiste.
Elle découvre aussi une société musulmane, séduite par l’appel du muezzin. Toujours mal acceptée par ses proches, elle ne fait aucun effort pour « s’intégrer », ni à apprendre le Malenké, ni à porter des pagnes. D’ailleurs à quoi bon?
« Peu à peu, je comprenais qu’il ne suffisait pas d’apprendre à parler le malenké, mais qu’il fallait surtout apprendre à considérer le monde comme composé de deux hémisphères distincts, celui des hommes et celui des femmes. »
Pourtant, elle demande la nationalité guinéenne. Elle obtient un poste de professeur de Français dans un collège. Fréquente des intellectuels et des révolutionnaires, Hamilcar Cabral, le Cap-Verdien, Louis Gbehanzin, un prince béninois. Le socialisme de Sekou Touré s’avère bien inégalitaire
Chaque jour davantage, la société se divisait en deux groupes, séparés par une mer infranchissable de
préjugés. Alors que nous bringuebalions dans des autobus bondés et prêts à rendre l’âme, de rutilantes
Mercedes à fanions nous dépassaient transportant des femmes harnachées, couvertes de bijoux, des
hommes fumant avec ostentation des havanes bagués à leurs initiales.
Culte de la personnalité, pénuries, surtout répression politique sévère
« le « complot des enseignants ». Il est à déplorer qu’ils aient fait l’objet de très rares publications. Ils constituent le premier crime organisé sur une grande échelle par le régime de Sékou Touré. Ce fut une véritable purge qui tenta d’abord d’éliminer l’ennemi Peul, mais s’attaqua aussi à tous les patriotes. »
A Conakry, elle ne parvient plus à subvenir aux besoins de ses quatre enfants . Elle va partir, à Dakar puis au Ghana à Accra, plus prospère mais toujours socialiste accueillant divers militants étrangers Freedom fighters. Avec un « garant révolutionnaire », elle va obtenir un bon poste d’enseignante. Elle se heurte encore au machisme qui va jusqu’au viol. Culte de la personnalité
« Cependant, l’élément le plus frappant de cet ensemble architectural était une gigantesque statue de
Kwame Nkrumah, un livre à la main. Elle était sise au mitan de la place du même nom, car Winneba était
le lieu d’un culte de la personnalité tel que je n’en avais jamais imaginé. »
Au centre de Winneba, où elle enseigne, visite de Malcom X et de Che Guevara
« En effet, sitôt que j’eus mis le pied à Winneba, je compris que j’eus été parachutée dans une Afrique
entièrement différente de celle où j’avais vécu et où je n’avais pas ma place : celle des puissants et de ceux
qui aspiraient à le devenir. »
Un coup d’état va la chasser du Ghana, elle est emprisonnée comme espionne et expulsée.
Séparée de Condé, elle vit une histoire d’amour avec un avocat séduisant sans avertir son mari. « Sans fards »
« Épouse menteuse, épouse infidèle, épouse adultère, je ne lui rendais pas l’existence facile. Il était évident
que, moi aussi, je le détruisais. »
Les passions, les amours, les relations plus ou moins consenties ne font pas de l’héroïne un personnage très sympathique. j’ai parfois du mal à la suivre, surtout quand elle disperse ses enfants, les confie à des étrangers…
En revanche, le récit est passionnant si on s’intéresse à cette période des Indépendances Africaines. De Dakar à Conakry, Acra, Abomey et même Lagos, elle a parcouru l’Afrique et rencontré révolutionnaires, intellectuels, écrivains.
Un autre aspect est le livre d’apprentissage : comment la mère de famille devient une écrivaine?
C’est à Londres qu’elle atterrit, expulsée du Ghana qu’elle devient journaliste et se fait apprécier à la BBC. Elle retourne à l’Université étudier l’histoire du colonialisme et la sociologie du développement.
« Un soir après le dîner, alors que les enfants étaient endormis, j’attirais à moi la machine Remington verte que j’ai gardée pendant des années, sur laquelle j’ai rédigé les deux volumes de Segou »
Ses allers-retours en Afrique ne sont toujours pas terminés. Maintenant j’ai compris pourquoi la Guadeloupéenne a écrit Segou et pourquoi l’Afrique est présente même dans les romans antillais.
A lire et à relire, rien que pour toutes les références littéraires, une PAL entière de littérature africaine, de Sembene à Soyinka, Senghor, Fanon et tant d’autres. A relire aussi en même temps que ses romans inspirés de ses expériences….


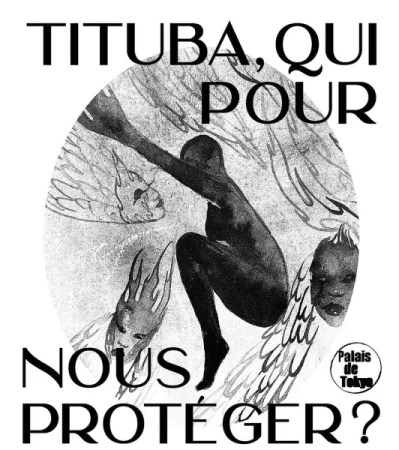



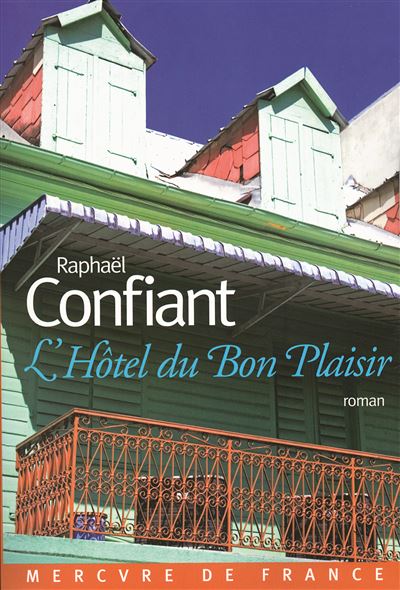

 Condé,
Condé,